 On a évoqué en cours ce sentiment particulier qui nous traverse lorsque face à une oeuvre, on dépasse le simple plaisir de l’instant, pour accéder à une autre satisfaction, moins personnelle et moins immédiate, que ce soit cette certitude de reconnaître les mêmes formes que les autres spectateurs, dans une salle de cinéma projetant, par exemple, un Tarantino, ou l’impression, parfois, d’entendre un morceau qui n’est pas un simple effet de mode, mais se présente déjà comme un classique.
On a évoqué en cours ce sentiment particulier qui nous traverse lorsque face à une oeuvre, on dépasse le simple plaisir de l’instant, pour accéder à une autre satisfaction, moins personnelle et moins immédiate, que ce soit cette certitude de reconnaître les mêmes formes que les autres spectateurs, dans une salle de cinéma projetant, par exemple, un Tarantino, ou l’impression, parfois, d’entendre un morceau qui n’est pas un simple effet de mode, mais se présente déjà comme un classique.
Certains élève citaient en exemple l’étrange impression mixte éprouvée lorsqu’ils entendirent pour la première fois l’Empire state of mind de Jay-Z et Alicia Keys : était-ce un nouveau titre ? Leur était il contemporain ? Ou bien venaient ils de découvrir un morceau bien plus ancien, composé et enregistré avant leur naissance, qu’un programmateur radio aurait ressorti de l’oubli pour en faire, de nouveau, profiter des oreilles plus jeunes ? Ce titre, bien que fortement inscrit dans son époque, sonne comme quelque chose qui échapperait à son ancrage, comme un bateau fantôme dont on recevrait encore quelques messages émis en morse qui recouvriraient les parasites des échanges actuels.
C’est que les oeuvres d’art ont ceci de particulier, par rapport aux simples objets dont la seule raison d’être est le divertissement, de nous éveiller à une sensibilité qui ne serait pas platement subjective, et de nous ouvrir à une dimension du temps originale, comme détachée de l’époque dans laquelle on se tient, sans qu’il s’agisse non plus de se téléporter simplement dans une autre période afin d’échapper à la nôtre et de s’en protéger. C’est bien ici et maintenant que l’expérience se vit, mais c’est comme si elle avait toujours été donnée à vivre, comme si elle était indépendante des contingences de l’ici et du maintenant, comme si finalement, j’aurais tout aussi bien pu la vivre si je n’étais pas moi même.
Cette temporalité paradoxale pourrait être un des signes distinctifs de ce qu’on appelle un « classique », c’est à dire une oeuvre qui semble être libérée des déterminismes liés aux conditions de son apparition dans le monde. Mais parler ainsi de « classique » ne serait pas juste s’il s’agissait seulement de faire référence aux oeuvres du passé. On associe trop facilement les styles du passé à une sorte d’intemporalité, alors que, par exemple, la musique baroque était souvent composée pour n’être jouée qu’une seule fois et aussitôt disparaître, exactement comme le sont les ‘singles’ de notre temps. Le plus intéressant consiste peut être au contraire dans cette « impression de classicisme » éprouvée face à des oeuvres tout à fait actuelles, à ce doute que nous avons en écoutant un titre jusque là inconnu, éprouvant l’impression de l’avoir déjà entendu, d’avoir toujours été accompagné par lui, ressentant même le lien qui l’unit à l’humanité toute entière, donc on est convaincu qu’elle a toujours vécu en sa compagnie, qu’il fait partie de son paysage immuable, sans pouvoir pourtant discerner à quels moments, et dans quelles circonstances précises il nous aurait croisé, et sans pour autant qu’on puisse dire que cette impression soit due à une simple ressemblance avec tel autre morceau déjà connu. On le devine, n’associer le classicisme qu’au passé et aux arts « savants », laissant de côté les rencontres actuelles avec des oeuvres relevant des « arts populaires », c’est singulièrement limiter l’extension du classicisme, et restreindre notre aptitude à l’éprouver puisque ça réduit cette expérience à être capable d’apprendre par coeur des listes officielles de « classiques », et d’être capable de les restituer à l’identique, reproduisant une érudition artificielle, détachée de toute vie esthétique véritable.
Spontanément, on serait donc tenté d’opposer le classicisme au contemporain. On aurait tendance à privilégier l’éternité contre une inscription un peu trop nette dans sa propre époque d’origine. Il faudrait éviter d’être « de son temps », afin d’échapper à l’actualité, et saisir une portion de temps qui dépasse notre propre inscription nécessairement limitée dans ce laps de temps qui court de notre naissance à notre mort.
Dans son très court ouvrage, Qu’est ce que le contemporain ?, restitution de sa leçon inaugurale donnée en 2005 en introduction à son cours de philosophie théorétique à l’Université de Venise, Giorgio Agamben tente précisément de saisir ce rapport étrange qu’entretiennent l’actualité et son propre dépassement :
« Cette relation particulière au passé a également un autre aspect.
La contemporanéité s’inscrit, en fait, dans le présent en le signalant avant tout comme archaïque, et seul celui qui perçoit dans les choses les plus modernes et les plus récentes les indices ou la signature de l’archaïsme peut être un 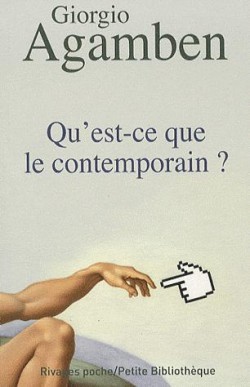 contemporain. Archaïque signifie proche de l‘arké, c’est à dire de l’origine. Mais l’origine n’est pas seulement située dans un passé chronologique : elle est contemporaine du devenir historique et ne cesse pas d’agir à travers lui, tout comme l’embryon continue de vivre dans les tissus de l’organisme parvenu à maturité, et l’enfant dans la vie psychique de l’adulte. L’écart – et tout ensemble l’imminence – qui définit la contemporanéité trouve son fondement dans cette proximité avec l’origine, qui ne perce nulle part avec plus de force que dans le présent. Qui a vu pour la première fois, arrivant par la mer à l’aube, les gratte-ciel de New-York, a subitement perçu ce facies archaïque du présent, cette contiguïté avec la ruine que les images atemporelles du 11 septembre ont rendus évidents pour tous [note du moine copiste : on pourrait ici se demander qui aujourd'hui encore arrive par la mer à Manhattan ? Réponse : les travailleurs qui, quotidiennement abordent l'île via les ferrys orange en provenance de Staten Island, et il n'est pas intéressant de penser que des travailleurs soient quotidiennement éprouvés par l'inactualité de leur environnement. D'autre part, si la skyline new-yorkaise nous renvoie vers l'absence des deux tours du WTC, elle est aussi, vue au lointain avec, au premier plan, le colosse qu'est la Statue de la liberté, l'écho lointain d'une Cité antique qui ne serait pas mimée, mais présente dans sa plus stricte actualité].
contemporain. Archaïque signifie proche de l‘arké, c’est à dire de l’origine. Mais l’origine n’est pas seulement située dans un passé chronologique : elle est contemporaine du devenir historique et ne cesse pas d’agir à travers lui, tout comme l’embryon continue de vivre dans les tissus de l’organisme parvenu à maturité, et l’enfant dans la vie psychique de l’adulte. L’écart – et tout ensemble l’imminence – qui définit la contemporanéité trouve son fondement dans cette proximité avec l’origine, qui ne perce nulle part avec plus de force que dans le présent. Qui a vu pour la première fois, arrivant par la mer à l’aube, les gratte-ciel de New-York, a subitement perçu ce facies archaïque du présent, cette contiguïté avec la ruine que les images atemporelles du 11 septembre ont rendus évidents pour tous [note du moine copiste : on pourrait ici se demander qui aujourd'hui encore arrive par la mer à Manhattan ? Réponse : les travailleurs qui, quotidiennement abordent l'île via les ferrys orange en provenance de Staten Island, et il n'est pas intéressant de penser que des travailleurs soient quotidiennement éprouvés par l'inactualité de leur environnement. D'autre part, si la skyline new-yorkaise nous renvoie vers l'absence des deux tours du WTC, elle est aussi, vue au lointain avec, au premier plan, le colosse qu'est la Statue de la liberté, l'écho lointain d'une Cité antique qui ne serait pas mimée, mais présente dans sa plus stricte actualité].
Les historiens de l’art et de la littérature savent qu’il y a entre l’archaïque et le moderne un rendez-vous secret, non seulement parce que les formes les plus archaïques semblent exercer sur le présent une fascination particulière, mais surtout parce que la clé du moderne est cachée dans l’immémorial et le préhistorique. C’est ainsi que le monde antique se retourne, à la fin, pour se retrouver, vers ses débuts : l’avant-garde, qui s’est égarée dans le temps, recherche le primitif et l’archaïque. C’est en ce sens que l’on peut dire que la voie d’accès au présent a nécessairement la forme d’une archéologie. Celle-ci ne nous fait pas remonter à un passé éloigné, mais à ce que nous ne pouvons en aucun cas vivre dans le présent. Demeurant non vécu, il est sans cesse happé vers l’origine sans pouvoir jamais la rejoindre. Le présent n’est rien d’autre que la part de non-vécu dans tout vécu, et ce qui empêche l’accès au présent est précisément la masse de ce que, pour une raison ou pour une autre (son caractère traumatique, sa trop grande proximité) nous n’avons pas réussi à vivre en lui. L’attention à ce non-vécu est la vie du contemporain. Et être contemporains signifie, en ce sens, revenir à un présent où nous n’avons jamais été. «
Giorgio Agamben – Qu’est ce que le contemporain ? p. 33 sq; 2008
Peut-être, dès lors, une des plus belles expériences d’un tel classicisme fut donnée ces derniers mois au cours des séquences entrevues (et très largement diffusées, tant elles sont simplement réjouissantes) dans le show télévisé de Jimmy Fallon, transfuge du Saturday Night Live, émission matrice du divertissement contemporain, au cours desquelles Justin Timberlake est venu, par trois fois, reprendre les standards du rap de ces trente dernières années. Au-delà du caractère simplement joyeux de ces trois épisodes, qui rappellent la simplicité festive qu’espérait, par exemple, Rousseau, on sent bien qu’on a du mal à mesurer tout ce qui dépasse l’ici, et le maintenant, de ces séquences. D’abord parce qu’elles dépassent le simple goût qu’on peut avoir, ou pas, pour le rap. Les premières onomatopées du Raper’s delight, du Sugarhill Gang nous renvoient en 1978 juste le temps d’en décoller ausitôt parce que ce titre est simplement la matrice de tout le reste, non seulement du rap, mais même, de l’expression orale tout court : comment des paroles aussi basiques que « i said a hip hop the hippie the hippie to the hip hip hop, a you dont stop the rock it to the bang bang boogie say up jumped the boogie to the rhythm of the boogie, the beat » ont elles pu nous habiter depuis si longtemps, sans qu’on s’en aperçoive, au delà même des mots prononcés, dont on n’a qu’une conscience obscure, mais dans leur rythme, dans la tonalité joyeuse de la voix, dans le jeu de la scantion, dans le flot de la parole, dans le flow en somme ? Une fois la matrice consciemment réinstallée en nous, les portes sont ouvertes, et ce n’est pas à une visite de l’histoire du rap qu’on est convié, c’est à une exploration en règle des coins empoussiérés de notre mémoire non apprise : ces séquences, ces voix, semblent avoir été là depuis toujours, tellement « là » qu’on ne s’est même pas aperçu de leur présence, qui semblait aller de soi. Et y être confronté comme ça, dans un condensé temporel tellement rapide qu’il ne laisse pas le temps de retrouver ses repères, déconnecté du contexte auquel il est censé être associé (le rap, ici, est pratiqué en veste croisé, et en cravate, et ce sont deux blanc-becs qui s’y collent, et ils parviennent à ne pas être ridicules), à tel point qu’on sent bien que n’importe quel rappeur « légitime » vivrait cette séquence exactement comme le novice la ressent, c’est à dire comme un cadeau inespéré. Il n’est plus nécessaire d’accompagner ce condensé de l’histoire du rap du folklore qui l’a vu naître et se développer, parce qu’ici, il ne s’agit plus que de pures formes, d’ensembles cohérents de sons, de mots, d’attitudes qui existent désormais par eux mêmes, à travers ceux qui, même sans les écouter vraiment, les ont tout simplement en tête.
Peut être, finalement, qu’un des éléments les plus essentiels de ces trois séquences consiste en ceci : ceux qui les ont vues en direct, alors qu’un de leur principe, c’est qu’elles ne soient pas annoncées, qu’elles tombent pour ainsi dire du ciel (le spectateur attentif scrute, désormais, si les musiciens de The Roots se tiennent sur la tribune, car ils sont le présage d’un épisode supplémentaire) sont partagés entre le simple plaisir de vivre ces quelques minutes et le besoin impérieux d’envoyer des messages à l’univers tout entier pour qu’il se branche sur le Late Night with Jimmy Fallon. Et s’il en va ainsi dans nos sensibilités, c’est bel et bien qu’à ce moment précis, elles ne sont plus aussi subjectives que nous aimerions bien le penser, qu’il ne s’agit plus simplement de se faire plaisir, mais d’espérer que ce plaisir puisse être partagé bien au-delà de nos goûts personnels. S’il s’agit encore ici d’assouvissement, on discerne qu’il n’est plus personnel, et qu’il y a là une aspiration à être connecté avec plus grand que soi, non pas parce que l’objet relèverait d’une subtilité intellectuelle inaccessible, mais précisément parce qu’on est mis devant l’évidence que quelques poignées de titres repris dans la plus grande simplicité, sont porteurs d’une expérience inespérée. Et si Agamben pointe dans sa réflexion la possibilité d’accéder à ce qui, dans le temps, est hors d’accès, on peut étendre le motif de la méditation, en saisissant que parfois, une expérience tout aussi paradoxale est envisageable en direction dessubjectivités que nous ne sommes pas.
Il était difficile de laisser là le lecteur, sans lui proposer ces séquences auxquelles on faisait référence. Comme tout le monde, une fois passé la vague d’enthousiasme, se rend compte qu’en fait, il aime le rap sans le connaître, on a accompagné chaque épisode des références qui permettront d’aller rencontrer pour de bon ce que jusque là on a vécu sans le savoir. On découvrira, si jamais on avait à ce sujet quelques doutes, que le rap est une culture. Peut être que finalement, la joie qu’on éprouve devant elle est elle due en bonne partie à ce qu’une telle reconnaissance soit inespérée.
source: http://www.lyricsondemand.com/onehitwonders/rappersdelightlyrics.html
Cliquer ici pour voir la vidéo.
Sugarhill Gang – « Rapper’s Delight »
Run DMC – « Peter Piper »
Beastie Boys – « Paul Revere
A Tribe Called Quest – « Award Tour »
Digital Underground – « Humpty Dance »
Snoop Doggy Dogg – « Ain’t Nutt’N But G Thang »
2Pac – « California Love »; Notorious B.I.G. – « Juicy »
The Roots – « The Seed (2.0) »
Eminem – « My Name Is »
Missy Elliott – « Work It »
Soulja Boy Tell’em – « Crank That »
T.I. ft. Rihanna – « Live Your Life »
Kanye West ft. Jamie Foxx – « Gold Digger »
Jay-Z ft. Alicia Keys – « Empire State of Mind »
Cliquer ici pour voir la vidéo.
Kurtis Blow – The Breaks
Grandmaster Flash – The Message
NWA – Express Yourself
Public Enemy – Bring the Noise
Rob Base and DJ EZ Rock’s - It Takes 2
Salt-N-Pepa – Push It
Vanilla Ice – Ice Ice Baby
Black Sheep – The Choice is Yours
Cypress Hill – Insane in the Membrane
DJ Kool – Let Me Clear My Throat
DMX – Party Up (Up in Here)
Nelly – Hot in Herre
50 Cent – In Da Club
Outkast – Hey Ya
Lil Wayne – A Milli
DJ Khaled – All I Do Is Win
Cali Swag District – Teach Me How To Dougie
Rick Ross – B.M.F.
Biz Markie – Just a Friend
Cliquer ici pour voir la vidéo.
Run-DMC – “King of Rock”
LL Cool J – “Mama Said Knock You Out”
DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince – “Parents Just Don’t Understand”
De La Soul – “Me, Myself, and I”
JJ Fad – “Supersonic”
Sir Mix-a-Lot -”Baby Got Back”
Young MC -”Bust a Move”
House of Pain – “Jump Around”
Ice Cube – “Today Was a Good Day”
Coolio – “Gangsta’s Paradise”
Fugees – “Killing Me Softly”
Beastie Boys – “Sabotage”
Jay-Z – “I Just Wanna Love You (Give It To Me)”
Outkast – “Ms. Jackson”
Snoop Dog – “Drop It Like It’s Hot”
Kanye West – “Stronger”
Nicki Minaj – “Super Bass”
Naughty By Nature – “Hip Hop Hooray”
Et pour revenir, et conclure sur Giorgio Agamben, on précisera que, pour le lecteur débutant, un certain nombre de tout petits ouvrages sont disponibles en librairie, pour un coût vraiment très modéré, permettant de découvrir la pensée de cet auteur contemporain majeur. Il y a dans ces opuscules un potentiel de pensée considérable. Pour à peine une quarantaine de pages lues, vous en prenez pour vingt ans de méditation. On peut difficilement imaginer un meilleur rapport qualité/effort/prix.